
Prévention en santé
La prévention en santé a été définie par l’OMS en 1948 comme « l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. » Elle repose sur deux approches complémentaires qui permettent d’agir à différents niveaux et auprès de populations variées.

Biomarqueurs
Chaque jour qui passe, la médecine progresse grâce à une meilleure compréhension des mécanismes à l’œuvre dans le corps humain. Ces indicateurs biologiques, véritables signatures de maladies ou de réponses aux thérapies, permettent au personnel soignant d’adapter la prise en charge des…
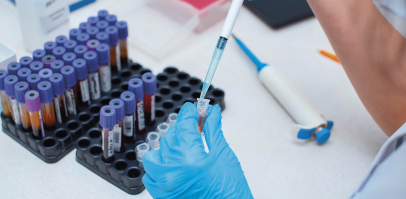
Dépistage
Le dépistage est un outil primordial dans la lutte contre les maladies, en particulier pour les cancers. Il permet de détecter précocement des anomalies et d’augmenter ainsi les chances de guérison et réduire la mortalité. Les avancées technologiques et médicales améliorent sans cesse…

Facteurs de risques
De nombreuses pathologies pourraient être évitées si l’on était plus attentifs à leurs facteurs de risque. Tabagisme, alimentation déséquilibrée, sédentarité ou encore stress chronique : ces éléments influencent directement la santé et augmentent la probabilité de développer des…

Santé des jeunes
À l’adolescence et au début de l’âge adulte, de nombreux changements physiologiques, psychologiques et sociaux influencent le bien-être. Ces transformations rendent certains jeunes plus vulnérables et peuvent faire émerger des troubles alimentaires, fragiliser la santé mentale ou donner…
Définition
La première approche définit trois stades de prévention en santé : primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire vise à éviter l’apparition de maladies en réduisant les facteurs de risque, par exemple grâce à des campagnes de vaccination ou des actions pour promouvoir une alimentation équilibrée. La prévention secondaire se concentre sur le dépistage précoce et le traitement des maladies pour limiter leur progression, comme les campagnes de dépistage de certains cancers. La prévention tertiaire cherche à réduire les complications d’une pathologie par des actions de rééducation ou même de réinsertion sociale et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. On parle également depuis une dizaine d’année de prévention quaternaire pour éviter les actes inutiles sur les patients.
La seconde approche, issue du champ de la santé publique, distingue trois types de préventions en santé : universelle, sélective et ciblée. La prévention universelle concerne l’ensemble de la population, indépendamment des risques individuels, tandis que la prévention sélective intervient sur des sous-groupes présentant des facteurs de vulnérabilité spécifiques, comme les jeunes dans les milieux défavorisés pour prévenir les addictions. La prévention ciblée, quant à elle, s’adresse aux individus déjà identifiés avec des facteurs de risque spécifiques comme les femmes enceintes avec la glycosurie ou présentant des signes précoces de trouble. Ces deux cadres permettent une articulation efficace des actions de prévention en fonction des besoins.
Les principaux domaines de la recherche sur la prévention
La recherche sur la prévention en santé touche aux déterminants de la santé, à l’optimisation des interventions et à leur mise en œuvre. Les recherches et les études s’appuient sur des approches interdisciplinaires combinant la médecine, la neurologie, la biologie, la sociologie, la psychologie, l’épidémiologie, l’écologie…
La recherche sur les déterminants de la santé comprend l’étude des facteurs de risque biologiques, comportementaux, environnementaux et sociaux, l’analyse des inégalités de santé et de leurs impacts sur l’accès aux soins préventifs et l’identification des interactions entre génétique et environnement.

La recherche sur les comportements analyse les mécanismes comportementaux pour promouvoir des modes de vie sains ; elle comprend également des études sur l’impact des campagnes de sensibilisation et des messages de santé publique ainsi que la mise au point de méthodes pour encourager l’adhésion aux interventions préventives.
La prévention des maladies chroniques et non transmissible regroupe la recherche sur les stratégies pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de maladies comme le diabète, l’obésité, et les cancers ; les études sur l’intégration des nouvelles technologies dans le suivi et la prévention (e-santé, télémédecine) ; l’analyse des interactions entre maladies chroniques et modes de vie.
La prévention des maladies infectieuses comprend les études sur le développement de vaccins plus efficaces et accessibles ; la recherche sur les approches communautaires pour limiter la propagation des épidémies ; la surveillance des résistances antimicrobiennes et la prévention de leur émergence.
La santé mentale et la prévention psychosociale s’est beaucoup développée au travers de la recherche sur les programmes pour réduire le stress, l’anxiété, la dépression et prévenir le suicide ; avec l’analyse de l’impact des facteurs sociaux (isolement, précarité) sur la santé mentale ; ainsi que les études sur l’efficacité des interventions numériques (applications et thérapies en ligne).
La santé environnementale et la prévention liée au climat sont également un domaine de recherche privilégié qui regroupe l’impact des expositions aux polluants et des changements climatiques sur la santé ; le développement de stratégies préventives pour limiter les effets des catastrophes environnementales ; la recherche sur l’impact des politiques publiques environnementales sur la santé.
L’éthique et les politiques de prévention comprennent des études sur l’équilibre entre liberté individuelle et interventions coercitives (par exemple, la vaccination obligatoire) ; la recherche sur les politiques de santé publique favorisant l’équité dans l’accès à la prévention ; l’analyse des implications éthiques des technologies prédictives en santé.
La prévention en santé dans le milieu du travail et dans les écoles regroupe les études sur les programmes visant à réduire les maladies professionnelles et les risques psychosociaux et les évaluations des interventions pour promouvoir la santé des enfants et adolescents dans les établissements scolaires.

L’intégration des technologies dans la prévention en santé s’attache au développement de solutions numériques pour le suivi personnalisé (applications, capteurs connectés) ; la recherche sur l’efficacité des outils d’intelligence artificielle dans le dépistage et la prédiction des risques ; les études sur l’acceptabilité et l’impact de ces technologies sur les populations cibles.
L’évaluation des interventions de médecines préventives se fait grâce à des études d’efficacité et de coût-efficacité des programmes de prévention (par exemple, les campagnes de vaccination ou dépistage) ; la recherche sur l’optimisation des stratégies de prévention universelle, sélective et ciblée ; le développement et la validation de nouveaux outils de dépistage et d’intervention.
Les avancées récentes et les priorités de la prévention de la santé
Les actions de prévention en santé ont récemment connu des avancées significatives grâce à une approche multidimensionnelle et à l’intégration des innovations technologiques.
Parmi les initiatives notables, la généralisation des programmes de dépistage ciblés, comme ceux pour le cancer ou les maladies cardiovasculaires, a permis d’améliorer les diagnostics précoces, tout en réduisant les inégalités d’accès aux soins préventifs.
Par ailleurs, la prévention des maladies chroniques bénéficie d’un essor des outils numériques tels que les applications de suivi personnalisé et les dispositifs connectés, offrant des solutions adaptées aux besoins individuels.
Les campagnes de sensibilisation, renforcées par des stratégies comportementales issues de la recherche en psychologie, jouent un rôle crucial pour promouvoir des habitudes de vie saines, notamment auprès des populations vulnérables.
En outre, la prévention environnementale et liée au climat s’impose comme une priorité, avec des efforts accrus pour atténuer les effets des polluants et des catastrophes climatiques sur la santé.
Enfin, le développement des politiques publiques inclusives, visant à garantir une prévention équitable et éthique, ainsi que la prévention psychosociale pour améliorer le bien-être mental, constituent des axes majeurs pour les années à venir.
En France, le lancement de la Stratégie d’Innovation Prévention en santé a été annoncé le 28 août 2024 par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec l’Agence de l’innovation en santé et le secrétariat général pour l’investissement. Elle est pilotée par l’Agence de l’innovation en santé.