
Biomarqueurs
Chaque jour qui passe, la médecine progresse grâce à une meilleure compréhension des mécanismes à l'œuvre dans le corps humain. Ces indicateurs biologiques, véritables signatures de maladies ou de réponses aux thérapies, permettent au personnel soignant d’adapter la prise en charge des patients avec toujours plus de précision. À la Fondation de l’Avenir, nous soutenons activement la recherche dans ce domaine pour une médecine toujours plus efficace et mieux tolérée par le corps humain.
Comprendre les biomarqueurs : que sont-ils et à quoi servent-ils ?
Définition et explications
Un biomarqueur, ou marqueur biologique, est une caractéristique mesurable qui renseigne sur un processus biologique normal, un processus pathologique ou une réponse biologique à la suite d’une intervention, comme un traitement par exemple. Il peut s’agir d’une protéine spécifique dans le sang, d’une mutation génétique, d’un taux de glucose anormal ou encore de cellules tumorales circulantes détectées dans la circulation sanguine.
La détection des biomarqueurs repose sur des techniques de pointe qui permettent d’identifier, dans des échantillons biologiques comme le sang, l’urine, la salive ou le liquide céphalorachidien, des éléments aussi variés que l’ADN, l’ARN, des protéines ou des métabolites. Ces analyses reposent sur des méthodes innovantes, telles que les biopsies liquides, les tests immuno-enzymatiques, la spectrométrie de masse ou encore le séquençage de nouvelle génération (NGS).
Une fois détectés, ces biomarqueurs doivent être isolés à l’aide de techniques comme la centrifugation, la filtration, l’immunoprécipitation ou la PCR. Cela permet ensuite d’analyser leur concentration ou leur structure via des outils comme la spectrométrie de masse, la chromatographie liquide, le microarray ou encore le séquençage à haut débit.
Ces technologies sont aujourd’hui souvent intégrées dans une démarche plus globale, combinées à des examens cliniques, à de l’imagerie médicale ou encore à des algorithmes d’intelligence artificielle (IA). Ces outils permettent de croiser les données pour affiner les diagnostics, mieux prédire les risques et adapter les traitements aux besoins spécifiques de chaque patient.
Le rôle des biomarqueurs pour la santé
Les biomarqueurs sont des outils clés qui permettent de détecter ou de suivre l’évolution d’une maladie, de prédire une réponse à un traitement ou d’évaluer l’état de santé général d’un patient. Ils sont d’ailleurs classés en plusieurs catégories selon leur rôle, à savoir les biomarqueurs diagnostiques, les biomarqueurs pronostiques, les biomarqueurs prédictifs et les biomarqueurs de suivi.
Ces indicateurs biologiques servent dans tous les domaines de la médecine, notamment en oncologie, en cardiologie ou en neurologie.
En oncologie, par exemple, certains marqueurs tumoraux peuvent aider à identifier la nature d’une tumeur et à adapter le traitement en conséquence.
Ils peuvent aussi être utilisés dans le cadre de maladies neurologiques dégénératives, comme la maladie d’Alzheimer, pour laquelle la diminution de la protéine bêta-amyloïde 42 dans le liquide céphalorachidien ou la visualisation des plaques par tomographie par émission de positons (TEP) permet de diagnostiquer la maladie de façon précoce.
Pourquoi les biomarqueurs sont-ils cruciaux pour la santé publique ?
Les biomarqueurs présentent un intérêt majeur pour la santé, car ils permettent d’améliorer le diagnostic, le suivi et le traitement des maladies. Ils facilitent la détection précoce, augmentent les chances de succès des thérapies, aident à prévenir certaines complications graves et à ajuster les soins en temps réel selon l’évolution de la maladie.
Grâce aux biomarqueurs, il est par exemple possible de dépister certains cancers (comme le cancer colorectal ou celui de la prostate) à un stade où ils sont encore traitables avec de meilleures chances de guérison.
Un autre rôle majeur des biomarqueurs est qu’ils participent à développer la médecine personnalisée. En effet, en permettant d’identifier les caractéristiques biologiques propres à chaque patient, ces indicateurs contribuent à adapter les soins en réduisant les risques d’effets secondaires et en optimisant l’efficacité des traitements.
Cet aspect est particulièrement utile dans ce cadre de la médecine de précision, où les traitements sont ajustés selon les profils génétiques et moléculaires des individus.
Les biomarqueurs ont aussi un grand intérêt en recherche clinique où ils sont utilisés pour l’évaluation de nouveaux médicaments, ce qui permet d’accélérer leur développement et leur mise sur le marché.
Le patient au cœur de la recherche sur les biomarqueurs
Grâce à la recherche sur les biomarqueurs, les chercheurs proposent des traitements de plus en plus ciblés, de plus en plus efficaces et de mieux en mieux tolérés. Cela permet d’aller au-delà de l’approche « standard » pour entrer dans une médecine plus fine, plus respectueuse des besoins individuels.

Le patient est aussi au cœur de la recherche sur les biomarqueurs, car ce sont ses données biologiques (sang, tissus, analyses génétiques…) qui permettent d’identifier les signaux précoces d’une maladie, d’en suivre l’évolution ou d’évaluer l’efficacité d’un traitement. Sans l’implication des patients, ces recherches ne pourraient ni avancer, ni déboucher sur des outils de diagnostic ou de suivi plus personnalisés. Ils ont une place active dans leur propre prise en charge, en rendant les soins plus adaptés et plus réactifs.
Les avancées de la recherche sur les biomarqueurs
Les avancées dans ce domaine se construisent avec et pour les patients, afin que la recherche biomédicale soit toujours plus humaine et tournée vers une meilleure qualité de vie et de soins.
Progrès technologiques et découvertes récentes
L’essor de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies a permis de révolutionner l’analyse des biomarqueurs. Grâce aux algorithmes d’apprentissage automatique, il est désormais possible d’identifier des marqueurs complexes à partir de vastes bases de données.
Les progrès en biologie moléculaire permettent également de développer des tests de dépistage moins invasifs, comme les biopsies liquides, qui détectent les cellules tumorales circulantes ou des fragments d’ADN tumoral dans le sang. Ces avancées augmentent considérablement les chances de détection précoce des cancers et d’autres maladies graves.
De plus, le développement des technologies multi-omics, qui utilisent la génomique, la protéomique et la métabolique, facilite l’identification des biomarqueurs, particulièrement grâce aux progrès du séquençage et de l’analyse des données. En croisant ces données, les chercheurs obtiennent une vision globale et très précise du fonctionnement d’un organisme.
Ces avancées ouvrent la voie à des traitements plus ciblés, plus efficaces et qui réduisent le risque d’effets secondaires.
Applications concrètes dans la lutte contre les maladies
La recherche sur les biomarqueurs connaît des avancées majeures qui ouvrent de nouvelles perspectives pour améliorer la qualité de soins et de vie des patients. En oncologie, pour le cancer colorectal par exemple, le test immunologique de recherche de sang dans les selles (test FIT) permet aujourd’hui un dépistage simple des lésions précancéreuses. Cependant, la participation au dépistage n’est pas optimale, et ce, à cause de freins qui restent nombreux, comme le manque de sensibilisation ou la gêne liée à la réalisation du test. La recherche sur les biomarqueurs vise à découvrir de nouveaux biomarqueurs dont l’analyse serait plus “engageante” pour les patients, accroissant ainsi directement l’efficacité du dépistage organisé.
Pour les maladies cardiovasculaires, des biomarqueurs comme la troponine ultrasensible (une protéine libérée par le muscle cardiaque en cas de lésion) permettent aujourd’hui de diagnostiquer un infarctus dès les toutes premières heures.
Outre les lipides classiques comme le cholestérol LDL, le HDL ou les triglycérides, d’autres marqueurs biologiques sont aussi désormais considérés comme essentiels pour évaluer le risque cardiovasculaire. C’est notamment le cas de l’Apolipoprotéine B, dont le taux élevé a été lié à un risque accru d’infarctus du myocarde. Son dosage est particulièrement recommandé chez les personnes atteintes d’hypertriglycéridémie, d’obésité ou de diabète.
La lipoprotéine (a) est également au cœur des préoccupations : lorsqu’elle dépasse un certain seuil, elle augmente significativement le risque de maladie coronaire ou d’accident vasculaire cérébral.
Les avancées récentes dans la recherche sur les biomarqueurs contribuent aussi à détecter plus précocement des maladies neurodégénératives. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, qui repose sur une approche multidisciplinaire, inclut notamment l’analyse de marqueurs biologiques dans le liquide cérébrospinal et la visualisation par imagerie médicale. Grâce aux récentes avancées techniques, de nouveaux biomarqueurs sanguins prometteurs sont étudiés, ouvrant la voie à un dépistage plus précoce et moins invasif. Ces outils pourraient bientôt permettre non seulement d’affiner le diagnostic, mais aussi de mieux accompagner les patients tout au long de leur parcours.
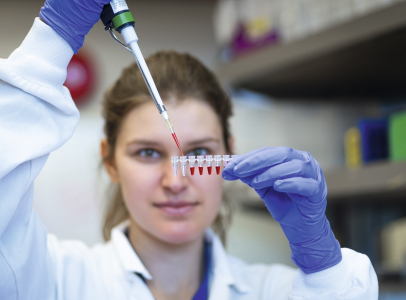
Projets de recherche prometteurs en cours
Identification de nouveaux biomarqueurs pour les maladies rares
L’un des défis majeurs posés par les maladies rares réside dans leur diagnostic. Bien souvent, les symptômes sont flous, atypiques et peuvent être confondus avec ceux de pathologies plus fréquentes, ce qui retarde le début de la prise en charge.
Utilisation de biomarqueurs pour mesurer l’impact de l’environnement sur la santé
La pollution, l’alimentation et d’autres facteurs environnementaux influencent notre santé et peuvent constituer des facteurs de risque de contracter certaines maladies. Des chercheurs analysent actuellement des biomarqueurs inflammatoires et métaboliques pour mieux comprendre l’impact des substances toxiques sur notre organisme et pour identifier les populations les plus vulnérables. C’est ce qu’on appelle la biosurveillance. Cette mesure se réalise par le dosage de biomarqueurs dans des prélèvements biologiques de sang, d’urine, de cheveux, ou encore de lait maternel.
La Fondation de l’Avenir soutient des projets innovants
À la Fondation de l’Avenir, nous soutenons de nombreuses équipes médicales et de chercheurs engagées dans des projets de pointe, afin d’accélérer les découvertes et d’apporter des solutions concrètes aux patients.
La Fondation de l’Avenir accompagne actuellement un projet d’étude moléculaire pré-clinique chez des patients, qui consiste à trouver le mécanisme des pathologies cardiovasculaires que sont l’anévrisme de l’aorte thoracique et la dissection aortique. Les chercheurs ciblent la dérégulation de la dynamique mitochondriale pour déterminer des biomarqueurs plasmatiques prédictifs de dissection ou de rupture aortique. La surveillance de ces biomarqueurs chez les patients pourrait permettre d’alerter de manière anticipée le risque de dissection et ainsi d’éviter une prise en charge d’urgence vitale.
La Fondation de l’Avenir contribue également à identifier des biomarqueurs spécifiques de la dégénérescence de la maladie de Parkinson. En effet, cette maladie se manifeste chez les patients par la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire, en partie expliquée par un stress des mitochondries qui vient accroître la vulnérabilité neuronale. L’équipe cherche donc à identifier les bases moléculaires de la susceptibilité de ces neurones au stress mitochondrial, par l’utilisation de cultures de neurones dopaminergiques issus de cellules pluripotentes induites de patients ou d’individus sains.
Grâce à votre soutien, nous pouvons financer ces recherches innovantes et contribuer à bâtir la médecine de demain. Faites un don pour aider les chercheurs à transformer ces avancées en traitements accessibles à tous !