
Place du patient
La Fondation de l’Avenir soutient depuis toujours des chercheurs qui mettent les patients au cœur de leurs projets. Longtemps considérés comme de simples objets d’étude, les patients sont aujourd’hui appelés à devenir des partenaires, détenteurs de savoirs et forces de propositions. Avec l’apport des sciences humaines et sociales, des réflexions éthiques et des innovations médicales, la place du patient dans la recherche est désormais pleinement reconnue et ouvre la voie à une science en prise avec la réalité des vies humaines, plus inclusive et plus démocratique.

Recherche en soin
La recherche en soin s’impose aujourd’hui comme un champ pluridisciplinaire nécessaire à l’évolution des pratiques de santé. À l’intersection des sciences médicales, sociales et technologiques, elle étudie le soin dans ses dimensions technique, relationnelle et éthique. En intégrant…

Recherche en soins infirmiers
Dans les hôpitaux, les EHPAD, les centres de soins ou encore à domicile, les infirmières et les infirmiers assurent la continuité des soins, la prévention et l’accompagnement des personnes malades ou dépendantes. Depuis plus de trente ans, la Fondation de l’Avenir soutient la recherche…
Du patient-sujet au patient-partenaire
Un rôle longtemps limité à la participation passive
Pendant une grande partie du XXᵉ siècle, le patient a été envisagé avant tout comme un sujet d’étude placé dans une situation de passivité vis-à-vis des chercheurs et des institutions médicales. Les protocoles de recherche étaient conçus sans consultation préalable des personnes concernées qui n’intervenaient qu’au moment de l’inclusion dans un essai clinique. Leur contribution se réduisait à fournir un consentement davantage formel qu’éclairé et à se soumettre aux examens définis par les équipes scientifiques. Cette approche a conduit à des déséquilibres. Par exemple, les femmes en âge de procréer ont été systématiquement exclues des essais cliniques jusque dans les années 1990, au nom d’un principe de précaution lié à une possible grossesse. De même, de nombreux patients issus de minorités sociales ou culturelles n’étaient pas représentés dans les cohortes. Dans ces conditions, la recherche médicale répondait davantage à une logique interne d’efficacité scientifique qu’à une recherche d’adéquation avec la diversité et la complexité des expériences de santé vécues par les patients.
L’émergence du patient-expert et des savoirs profanes
À partir des années 1990, la création d’associations de malades atteints du Sida a remis en question ce modèle. Les patients ont revendiqué une expertise issue de leur vécu, qu’ils ont mise au service de la recherche clinique et des politiques de santé. Cette dynamique a conduit à l’émergence du concept de « patient-expert », reconnu pour sa capacité à articuler savoir scientifique et savoir profane. Les sciences sociales ont montré que cette hybridation des connaissances enrichit les projets de recherche car elles intègrent le quotidien des personnes.
Les mouvements associatifs et la démocratie sanitaire
En France, la loi du 4 mars 2002 ou « Loi Kouchner », relative aux droits des malades, a marqué une nouvelle étape en introduisant la notion de démocratie sanitaire. Les associations de patients ont notamment acquis un rôle majeur dans la gouvernance de la recherche en participant aux comités d’éthique, aux instances de financement et aux choix des priorités de recherche. Leur présence dans les protocoles d’essais cliniques contribue désormais à réduire l’asymétrie entre chercheurs et participants et à garantir une meilleure représentativité des populations concernées.
Les nouveaux modèles de recherche participative

La participation des patients ne se limite plus à la validation de protocoles : elle s’étend à la co-construction des projets. La recherche-action, la co-conception des critères de résultats ou encore l’intégration de patients dans les équipes scientifiques traduisent cette évolution. Un exemple intéressant est celui des projets menés en santé mentale, où les patients contribuent à redéfinir les indicateurs de rétablissement traditionnellement centrés sur des critères cliniques, pour y inclure des dimensions de qualité de vie, d’autonomie ou d’intégration sociale. En oncologie ou dans le domaine des maladies rares, des projets pilotes associent directement les malades à l’élaboration des outils de suivi qui allient pertinence clinique et mesure de la qualité de vie.
Enjeux éthiques et responsabilités
Consentement libre et éclairé, un principe fondateur
Depuis la Déclaration d’Helsinki (1964) et le rapport Belmont (1979), le consentement éclairé constitue un pilier de la recherche biomédicale. Il est le principe éthique et juridique selon lequel une personne ne peut participer à une recherche médicale qu’après avoir reçu une information complète, compréhensible et adaptée sur les objectifs, les méthodes, les bénéfices attendus, les risques potentiels, ainsi que sur ses droits, notamment celui de se retirer à tout moment sans préjudice. Mais dans la pratique, ce consentement reste parfois formel, noyé dans des documents techniques peu accessibles. Les travaux récents sur les interfaces numériques de consentement cherchent à rendre ce processus plus compréhensible, notamment par l’usage de chatbots pédagogiques. Garantir un consentement véritablement « éclairé » suppose de reconnaître la diversité des compétences et des vulnérabilités des participants.
Autonomie, vulnérabilité et rapports de pouvoir
Les sciences humaines et sociales étudient depuis longtemps la relation de pouvoir entre chercheurs et patients. Dès les années 1960, Michel Foucault, dans Naissance de la clinique (1963) et Surveiller et punir (1975), analyse comment le savoir médical s’accompagne d’un pouvoir disciplinaire et inscrit les patients dans une position de dépendance face à l’institution médicale. On tend aujourd’hui vers un rééquilibrage de ce cadre avec des dispositifs de participation active et de partage de décision. Au Royaume-Uni, le PPI (Patient and Public Involvement) est devenu un cadre institutionnalisé depuis les années 1990. Il est aujourd’hui porté par le National Institute for Health and Care Research (NIHR), qui exige que tout projet financé démontre la participation active des patients et du public, de la définition de la question de recherche à la diffusion des résultats. Cependant, la recherche confronte souvent des participants vulnérables (enfants, personnes âgées, patients atteints de pathologies graves ou de handicap mental) à des choix complexes. L’enjeu est alors de concilier protection et autonomie, sans revenir au paternalisme médical.
Confidentialité et données de santé
Avec l’essor de la recherche génomique et des bases de données massives, la protection des données personnelles est devenue incontournable. Les patients s’interrogent sur la propriété et l’usage de leurs informations médicales. La mise en place de gouvernances collectives, impliquant des représentants de patients dans la gestion des biobanques et des bases de données, est une piste explorée dans plusieurs pays pour renforcer la confiance et éviter que la question des données soit un frein à la participation des patients à la recherche.
Représentativité dans les essais cliniques
L’un des enjeux actuels les plus importants reste la représentativité des participants. Trop souvent, certaines catégories comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les minorités sociales ou culturelles, sont exclues des protocoles. Or cette sous-représentation fragilise la validité des résultats et limite l’équité en santé. Par exemple, les grandes bases de données génétiques utilisées pour la recherche biomédicale (comme celles issues des projets de génomique) sont constituées à plus de 80% de participants d’origine européenne. Autre exemple en pharmacologie, le zolpidem (un somnifère) a longtemps été prescrit à la même dose pour les hommes et pour les femmes. Or, les essais initiaux comptaient très peu de femmes et ne tenaient pas compte de différences métaboliques. Des années plus tard, la Food and Drug Administration a reconnu que les femmes éliminaient plus lentement la molécule, ce qui entraînait une somnolence résiduelle le matin et un risque accru d’accidents de la route. La dose recommandée a été réduite de moitié pour les femmes.
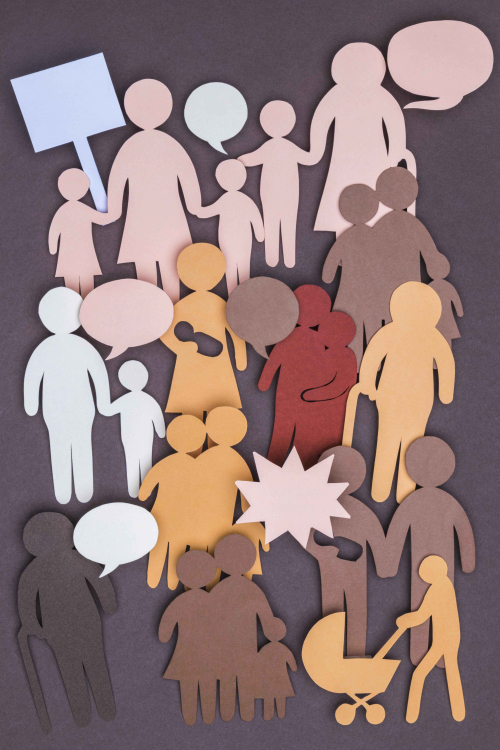
La participation des patients, moteur d’une recherche plus inclusive
De la consultation à la co-construction des projets
La participation des patients prend aujourd’hui des formes variées : consultation ponctuelle lors de l’élaboration d’un protocole, focus groups sur les attentes thérapeutiques ou implication continue dans la définition des priorités de recherche. Dans certains projets de recherche participative en santé mentale, par exemple, les patients sont membres à part entière des comités scientifiques et influencent la formulation même des hypothèses de recherche.
Les associations de patients comme acteurs scientifiques et politiques
Les associations de patients jouent un rôle de plus en plus important dans la diffusion d’une recherche plus démocratique. Certaines, comme celles engagées contre le cancer ou les maladies rares, cofinancent la recherche et définissent les critères de pertinence des projets soutenus. Leur action témoigne de la capacité des collectifs citoyens à infléchir l’agenda scientifique et à défendre des thématiques longtemps négligées par la recherche académique.
Les humanités médicales et la médecine narrative pour enrichir la recherche
Les humanités médicales rappellent que la recherche ne se réduit pas à des chiffres ou à des biomarqueurs. La prise en compte des récits de vie, des trajectoires sociales et des représentations culturelles éclaire la compréhension des maladies et de leurs traitements. La médecine narrative, par exemple, permet d’intégrer les récits des patients dans la construction des indicateurs de qualité de vie, renforçant la pertinence et l’humanité des recherches cliniques. En France, la discipline est encore émergente, mais quelques universités et centres hospitaliers expérimentent des programmes pilotes (ateliers de récit de maladie dans les soins palliatifs, enseignements à Paris, Lyon, Montpellier dans des DU d’éthique ou d’humanités médicales).
Évaluer l’impact et tracer les perspectives d’une science ouverte et citoyenne
La participation des patients est souvent invoquée comme un principe éthique ou démocratique. Mais sans évaluation de ses effets concrets, elle peut être réduite à une pratique symbolique. Mesurer l’impact permet de démontrer que cette participation ne relève pas d’un simple affichage, mais qu’elle améliore réellement la pertinence et la qualité de la recherche.
Les approches interdisciplinaires proposent d’associer indicateurs quantitatifs (nombre de projets co-construits, délais réduits, qualité des publications) et qualitatifs (satisfaction des participants, pertinence sociale des résultats). Ces outils permettront d’asseoir durablement la légitimité d’une science ouverte, inclusive et citoyenne.