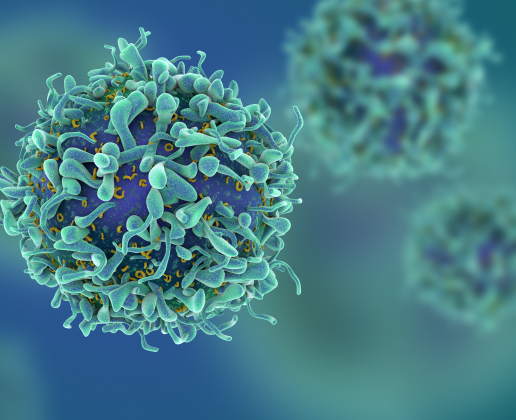
Immunothérapie
Le diagnostic d’un cancer est souvent vécu comme une épreuve bouleversante, tant pour les patients que pour leurs proches. Face à ce combat, une nouvelle lueur d’espoir a émergé ces dernières années : l’immunothérapie. Cette approche innovante transforme progressivement la manière dont les cancers sont traités, offrant à certains patients des perspectives de rémission durable, voire de guérison. Mais qu’est-ce que l’immunothérapie, et pourquoi suscite-t-elle autant d’enthousiasme dans le domaine de la cancérologie ?
Comprendre l’immunothérapie
Qu’est-ce que l’immunothérapie ?
L’immunothérapie repose sur une idée simple, mais puissante : mobiliser et renforcer les défenses naturelles de l’organisme pour lutter contre le cancer. Notre système immunitaire, composé de cellules comme les lymphocytes T et les macrophages, joue un rôle clé dans la surveillance et l’élimination des cellules anormales. Cependant, les cellules cancéreuses développent des stratégies sophistiquées pour échapper à cette vigilance et ne sont pas reconnues comme cellules anormales par le système immunitaire.
Grâce aux traitements d’immunothérapie, ces parades des cellules tumorales sont déjouées, permettant au système immunitaire de reconnaître et d’attaquer les cellules malignes. Ce traitement ne se contente pas de détruire les cellules cancéreuses, il éduque également l’immunité pour qu’elle soit prête à prévenir d’éventuelles rechutes.
Comment l’immunothérapie aide le système immunitaire à combattre le cancer
En réactivant le système immunitaire, l’immunothérapie agit comme un allié de taille contre les tumeurs. Pour survivre et proliférer, les cellules cancéreuses développent un arsenal moléculaire destiné à échapper au système immunitaire, qui a pour fonction de les détruire. Elles produisent notamment des anticorps monoclonaux, qui vont inhiber les points de contrôle du système immunitaire, en stimulant les lymphocytes T.
L’anticorps monoclonal est une protéine conçue en laboratoire pour cibler spécifiquement une molécule de la cellule tumorale. Elle permet ainsi au système immunitaire de cibler et de détruire les cellules cancéreuses, même lorsqu’elles se dissimulent.
Les effets de cette « réactivation » sont souvent spectaculaires, en particulier chez certains patients atteints de cancers avancés. On assiste à une véritable mobilisation des défenses immunitaires, comme si le corps reprenait enfin le contrôle face à cet envahisseur.

Les différences entre l’immunothérapie et les traitements conventionnels
Si les traitements traditionnels cytotoxiques (capables de détruire les cellules) comme la chimiothérapie ou la radiothérapie restent des armes majeures contre le cancer, ils s’attaquent directement aux cellules tumorales et peuvent parfois affecter les cellules saines. L’immunothérapie, elle, adopte une approche indirecte mais puissante : elle stimule le système immunitaire. Cette distinction explique pourquoi les effets secondaires de l’immunothérapie, bien qu’existants, diffèrent des réactions habituelles aux traitements cytotoxiques. Cela ouvre une voie nouvelle pour soigner les cancers, en complément des approches plus classiques.
L’immunothérapie peut être administrée de plusieurs manières : par voie orale sous forme de pilule ou de gélule, par perfusion intraveineuse ou encore par application cutanée. Certains traitements nécessitent une administration à l’hôpital, tandis que d’autres peuvent être pris directement à domicile.
L’immunothérapie n’est pas obligatoirement prescrite en première intention. Certains cancers se soignent très bien sans y avoir recours. Elle peut toutefois être prescrite en premier lieu pour certains types de cancers du poumon ou pour certains cancers très avancés comme le cancer de la peau métastatique (qui y répond avec succès, alors qu’il n’existait avant cela aucun traitement). Elle est aussi souvent préconisée dans des cas de cancer colorectal avancé, de cancer de la vessie, de leucémie, de cancer de la moelle osseuse (myélome), de cancer du rein, de cancer du sein (triple négatif métastatique), de certains cancers de la sphère ORL ou pour traiter le lymphome de Hodgkin.
Les types d’immunothérapie contre le cancer
Les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire
Dans la quête pour surmonter les cancers les plus résistants, les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire tels que Pembrolizumab, Nivolumab et Ipilimumab, représentent une avancée majeure. Ces traitements agissent en bloquant les freins du système immunitaire. Imaginez un soldat prêt à se battre, mais maintenu en retrait. En levant ces freins, ces médicaments permettent aux lymphocytes T d’agir pleinement contre les cellules cancéreuses.
Des résultats impressionnants ont été obtenus, notamment dans le traitement du mélanome ou du cancer du poumon.
Chaque jour, des avancées en la matière sont réalisées. La Fondation de l’Avenir soutient par exemple les recherches de la docteure Fanny Chalmain sur l’immunothérapie, qui visent à lever les freins du système immunitaire imposés par les cellules cancéreuses via les points de contrôle PD-1/PD-L1. Ses travaux ont montré qu’une baisse des lymphocytes T CD4 favorise l’activation des lymphocytes T CD8, améliorant ainsi la réponse aux traitements anti-PD1. Cette avancée pourrait permettre à davantage de patients de bénéficier efficacement de l’immunothérapie.
Ces avancées, qui semblaient inimaginables il y a encore quelques années, redonnent espoir à des milliers de patients.
Les thérapies cellulaires : CAR-T et autres approches
Pour certains patients atteints de cancers du sang, comme la leucémie ou le lymphome, une autre forme d’immunothérapie, appelée thérapie CAR-T, offre une solution révolutionnaire. Cette technique consiste à prélever des cellules immunitaires du patient, à les modifier génétiquement en laboratoire pour qu’elles ciblent spécifiquement les cellules tumorales, puis à les réinjecter dans l’organisme.
Cependant, dans certains cas, il arrive que ces CAR-T cells disparaissent du sang et permettent au cancer de revenir. C’est pourquoi la Fondation de l’Avenir soutient les chercheurs travaillant sur le développement de techniques pour comprendre ces disparitions et parvenir à terme à y remédier.
Les vaccins thérapeutiques contre le cancer
Les vaccins thérapeutiques actuels sont personnalisés et ciblent les mutations tumorales – les « néoantigènes » – propres à chaque patient. Le système immunitaire reconnaît alors les cibles tumorales les plus pertinentes pour chaque patient de manière individuelle.
Cette stratégie, bien qu’encore émergente, ouvre des perspectives passionnantes pour renforcer les traitements d’immunothérapies disponibles.

Efficacité de l’immunothérapie
Quels cancers sont traités par immunothérapie ?
Aujourd’hui, plus de 30 types de cancers bénéficient de l’immunothérapie comme option thérapeutique. Elle est notamment devenue une référence pour le traitement des cancers suivants :
- le carcinome épidermoïde de la tête et du cou,
- le mélanome,
- le cancer du poumon non à petites cellules,
- le cancer hépatocellulaire,
- le cancer des cellules rénales,
- le cancer urothélial,
- le lymphome de Hodgkin,
- l’instabilité des microsatellites dans le cancer du côlon,
- le cancer œsophagien,
- certains cancers du sein triple négatif métastatique.
Des essais cliniques élargissent son champ d’application à d’autres types de tumeurs, comme les cancers du pancréas ou du cerveau, offrant de nouvelles options à des patients qui en avaient peu auparavant.
Quels niveaux de guérison associés ?
Selon l’Institut Curie, l’immunothérapie est efficace chez 25 à 40 % des malades atteints d’un cancer. Pour ceux qui répondent au traitement, on observe une hausse significative du taux de survie pour certaines formes de cancer.
Elle est notamment très efficace contre le cancer du poumon non à petites cellules. En effet, l’étude ADRIATIC sur le durvalumab a démontré une réduction de 27 % du risque de décès chez les patients, lorsque l’immunothérapie est administrée après une chimiothérapie et une radiothérapie combinées. Le taux de survie global sur 36 mois est d’environ 57 %, contre 48 % pour les patients du groupe ayant reçu un placebo.
L’immunothérapie reste un champ de recherche très dynamique, dont le potentiel peut encore être développé.
Les effets secondaires courants de l’immunothérapie
Les effets secondaires de l’immunothérapie sont souvent liés à une suractivation du système immunitaire, ce qui peut entraîner des inflammations au niveau de certains organes, comme le foie, les poumons ou les intestins.
Parmi les effets secondaires les plus observés, on retrouve :
- la fatigue généralisée,
- un état grippal (courbatures, fièvre),
- des problèmes gastro-intestinaux (nausées, diarrhées),
- des problèmes de peau (éruptions cutanées),
- des dysfonctionnements de la thyroïde (hyperthyroïdie ou hypothyroïdie).
Parfois, il arrive aussi qu’un traitement par immunothérapie déclenche une maladie auto-immune.
La recherche s’attelle actuellement à comprendre les raisons et les facteurs qui engendrent ces effets afin de mieux les atténuer.
Comment gérer les effets secondaires ?
La gestion des effets secondaires repose sur une prise en charge précoce et adaptée. Grâce à des équipes médicales formées et à des traitements complémentaires, il est souvent possible de limiter les impacts négatifs tout en poursuivant le traitement.
Les avancées de la recherche en immunothérapie

Les découvertes récentes dans le domaine
La recherche en immunothérapie est en constante évolution. De nouvelles cibles thérapeutiques, comme les cytokines ou les cellules dendritiques, sont identifiées chaque année.
Des recherches récentes ont par exemple permis de démontrer l’efficacité de l’immunothérapie dans le traitement des cancers hormonodépendants comme le cancer du sein, lorsqu’elle est administrée avant la chirurgie oncologique. On observe alors une disparition complète des cellules cancéreuses dans 30 % des cas précoces (selon le groupe ELSAN), contre 13% sans immunothérapie.
Ces découvertes, soutenues par des avancées en génétique et en biologie moléculaire, permettent de développer des traitements toujours plus efficaces et précis.
Les essais cliniques : un pilier des progrès en immunothérapie
Les essais cliniques jouent un rôle fondamental dans l’évaluation des nouveaux traitements par immunothérapie. Grâce à ces études, des milliers de patients bénéficient d’un accès précoce à des thérapies prometteuses, tout en contribuant à faire avancer la médecine. Ces essais sont essentiels pour comprendre comment l’immunothérapie peut être combinée à d’autres approches, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie.
Le rôle des fondations et des dons dans l’accélération de la recherche
Enfin, il est impossible de parler des avancées en immunothérapie sans évoquer l’importance du soutien financier. Des fondations, comme la Fondation de l’Avenir, jouent un rôle crucial en finançant des projets innovants et en soutenant les chercheurs. Chaque don contribue directement à sauver des vies et à écrire une nouvelle page de l’histoire de la médecine. Contribuez à faire avancer la recherche en matière d’immunothérapie et de thérapies ciblées, faites un don à la Fondation de l’Avenir !
Recherches soutenues en immunothérapie
- Prédiction de la réponse à l’immunothérapie grâce à l’expression des gènes dans le sang – Romain Boidot
- Evolution mélanome cutané et de la résistance à l’immunothérapie – Armelle Prevost-Blondel
- Marqueurs de l’efficacité de l’immunothérapie dans le traitement des cancers ORL inopérables – Diane Evrard
- Levée de résistance aux immunothérapies – Fanny Chalmin
- Améliorer la réponse aux immunothérapies anticancéreuses – Élise Jacquin